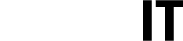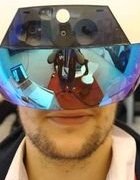phonlamaiphoto - stock.adobe.com
Libertés vs IA : le combat humaniste d’un informaticien philosophe
Jean-Gabriel Ganascia, qui se définit lui-même comme « chercheur en informatique et philosophe », est un spécialiste mondial et reconnu de l’IA. Membre du Comité National Pilote d’Éthique du Numérique (CNPEN), il ne cesse de souligner à quel point la liberté de l’être humain doit être facilitée, et non pas entravée, par la technologie.
L’homme, souriant au-dessus d’un discret nœud papillon, prend lentement ses papiers sur la table de son estrade. D’une voix douce, bien posée, il lit un poème. Dans le grand silence de cet amphi de l’Université de Montréal, les mots vibrent comme une profession de foi : « par le pouvoir d’un mot, je reconnais ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer – “Liberté” ».
Cet homme, qui termine ainsi par Eluard l’introduction de sa conférence, en juin 2022, au congrès TimeWorld, s’appelle Jean-Gabriel Ganascia. Il est Professeur d’informatique à Sorbonne Université – l’ancienne fac Jussieu –, membre du Comité National Pilote d’Éthique du Numérique (CNPEN), informaticien, philosophe, et spécialiste de l’intelligence artificielle.
La mer, un apprentissage de la liberté
La vie de Jean-Gabriel Ganascia commence en 1955, à Limoges. Son père est chirurgien militaire, et il suit ses parents au gré des affectations de son père. Jean-Gabriel Ganascia fait sa scolarité au collège Mignet d’Aix-en-Provence, et y décroche un bac C, qui lui ouvre la voie à une prépa Maths Sup et Spe au lycée Thiers, à Marseille.
Jean-Gabriel Ganascia est, à cette époque et de son propre aveu, « un jeune homme timide », étudiant studieux. Ses rares moments de loisir, il les passe sur les bateaux successifs mouillés au club nautique à Marseille, de son oncle, dont il est, avec un étonnement émerveillé, « le mousse » : « j’ai eu très tôt la fascination de la mer ». Un monde sans frontières ni entrave, où il découvre une conception de la liberté qui ne le quittera pas, et construit aussi sa vie de chercheur.
Lui qui a tant écrit sur la liberté individuelle face aux dérives de la technologie, a-t-il appris et compris en mer les secrets de cette liberté ? On se plaît à le croire, lorsqu’on entend le sourire dans sa voix en lui citant la fameuse phrase du poème de Baudelaire « L’Homme et la Mer », connue de tous les marins : « homme libre, toujours tu chériras la mer ».
Jean-Gabriel Ganascia « monte à Paris », pour faire ses études, et son service militaire comme cuirassier dans l’armée de Terre, dans un régiment de dragons. Pour tromper le temps et l’ennui d’une vie de garnison, il s’intéresse aux équipements des chars, notamment les caméras embarquées.
De là lui vient un intérêt pour l’informatique, l’optique, la reconnaissance et la modélisation de formes. Il enchaîne donc sur des études d’ingénieur à l’Institut d’optique théorique et appliquée à Orsay, dont il est diplômé en 1978.
Suivent deux DEA à l’Université Pierre et Marie Curie : un DEA d’acoustique théorique en 1979, et un DEA Intelligence Artificielle et Reconnaissance des Formes, en 1980. Il soutient en 1983 une thèse de docteur ingénieur à l’Université de Paris Saclay sur les systèmes à base de connaissance, et une thèse d’État en 1987 sur l’apprentissage automatique symbolique. Excusez du peu.
Informaticien qui philosophe… ou philosophe informaticien ?
En parallèle, il fait une licence et une maîtrise de philosophie à l’Université de Paris I (Panthéon Sorbonne). « Je le faisais en cachette, pour mieux me connaître », explique-t-il. Honte cachée, lui un scientifique, de se fourvoyer dans les « humanités » ? Volonté de préserver son jardin secret, et de tracer d’autres chemins, sans avoir de compte à rendre, plutôt.
Le milieu universitaire, riche de rencontres et de découvertes où une certaine liberté d’être s’accorde avec un cadre rassurant, lui plaît. Il entame une carrière universitaire comme assistant, puis maître de conférences, à l’Université de Saclay, avant de devenir en 1988 professeur à Sorbonne Université, anciennement Paris 6, puis université Pierre et Marie Curie, sur le campus Jussieu. Depuis, il y est chercheur et Professeur dans le fameux laboratoire de recherche LIP6, où il dirige l’équipe ACASA (Agents Cognitifs et Apprentissage Symbolique Automatique).
De là date son intérêt pour une approche pluridisciplinaire qui mêle étude de l’apprentissage et de la connaissance par des modélisations, les interfaces homme-machine, les sciences cognitives… et l’intelligence artificielle.
Le tout avec un questionnement qui commence à sourdre chez l’universitaire sur les limites et le sens profond de ces disciplines. Le socle de sa réflexion universitaire et humaniste est posé.
Le jeune universitaire trace son chemin, avec opiniâtreté, mais comme il le dit lui-même : « je n’avais pas du tout confiance en moi ». On a du mal à le croire, tant son parcours et ses connaissances sur l’IA, reconnus par ses pairs, forcent l’admiration.
À cette époque, il est, comme il le dit lui-même, un adepte de la science « positive » et du progrès tel qu’a pu le définir Auguste Comte. Malgré les visions prémonitoires de Philippe K. Dick, auquel on doit les romans qui ont inspiré les films « Blade Runner » et « Minority Report », la technologie, et notamment ce que l’on appelait alors les NTIC, ne sont pas vues comme un asservissement, mais comme une possibilité de libérer l’homme, et lui permettre de s’épanouir en lui donnant plus de temps, de choix.
« Je pensais que nous étions de gentils informaticiens, œuvrant pour le bien de l’Humanité, et non des apprentis sorciers », dit Jean-Gabriel Ganascia.
Lors d’une conférence, lui, le timide, se jette à l’eau et aborde le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, auteur du fameux « L’Homme Neuronal », paru en 1983. Il questionne la vision biologiste, très mécaniste du chercheur sur les sciences cognitives. Cet échange contradictoire le fait remarquer et, en 1993, Jean-Gabriel Ganascia crée et dirige le programme de recherche coordonné « Sciences Cognitives » pour le compte du ministère de la Recherche, puis le Groupement d’Intérêt Scientifique « Sciences de la Cognition » au ministère de la Recherche, avec la participation du CNRS, de l’Inria, et de l’Inrets, de 1995 à 2000.
Mais un tempérament libre comme le sien se montre vite réfractaire aux utilités de la vie publique. En d’autres termes, Jean-Gabriel Ganascia se rend rapidement compte qu’il préfère sa liberté d’universitaire aux antichambres des Ministères.
C’est dans cette optique qu’il devient membre, puis président du Comité d’éthique du CNRS, et qu’il travaille depuis longtemps à une approche humaniste et interdisciplinaire de la science : il collabore notamment avec les équipes littéraires de Sorbonne Université, avec lesquelles il a mis en place le labex (Laboratoire d’excellence) OBVIL (Observatoire de la vie littéraire), qu’il a co-dirigé de 2011 à 2021, et dont l’activité porte sur le versant littéraire des humanités numériques.
Technologie et servitude
Hasard ou pas, c’est à ce moment (au début des années 2000) qu’il commence à penser que la technologie, sous couvert de liberté, crée autant de servitudes cachées qu’elle est censée en abolir.
Sa réflexion évolue et se cristallise avec l’apparition des réseaux sociaux et la généralisation maintenant connue du ciblage de masse des individus, le développement de l’IA, l’émergence de théories sur l’homme augmenté vendues par des gourous du transhumanisme…
De plus en plus, ses travaux, ses écrits, ses ouvrages – il a écrit pas moins de 11 livres – interrogent clairement sur les limites et l’asservissement que peuvent créer des technologies censées nous libérer.
Dès 2017, il publie, aux éditions du Seuil, un ouvrage intitulé « Le mythe de la singularité : faut-il craindre l’intelligence artificielle », ou encore, « L’Intelligence artificielle : vers une domination programmée ? », aux éditions du Cavalier Bleu.
Deux ans plus tard, il signe, sous le pseudonyme Gabriel Naëj, un roman d’anticipation : « Ce matin, Maman a été téléchargée ». Son dernier en date, au titre on ne peut plus clair « Servitudes virtuelles », paru aux éditions du Seuil, a reçu le Prix du Livre FIC 2022.
Cette évolution n’a pas été, selon lui, brutale ni liée à un évènement particulier. C’est la prise de conscience progressive d’un chercheur « honnête homme », partisan du progrès et de la liberté de l’être humain, qui se rend compte petit à petit que les évolutions technologiques et l’IA mènent droit à un asservissement progressif, sournois, de l’âme et de l’intelligence. Et que l’être humain n’est plus libre de choix, qui lui sont dictés par des algorithmes sous prétexte de lui faciliter la vie. Une évolution entre les mains d’apprentis sorciers pas du tout altruistes, qu’il refuse, et dénonce. L’intelligence n’est certainement pas artificielle pour lui, et serait plus proche de la « conscience ».