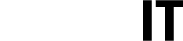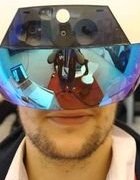Le paradoxe de l’IA générative cache un problème de stratégie IA
Si les entreprises n’observent pas des gains sonnants et trébuchants en matière d’IA générative, c’est qu’elles n’appliquent pas encore la bonne recette, selon QuantumBlack. Il faudrait revoir en profondeur quelques processus clés à l’aune de l’IA agentique. Ekimetrics et L’Oréal pensent que c’est une technologie parmi d’autres pour y parvenir.
Pendant deux ans, les grands groupes ont multiplié les expérimentations en matière d’IA générative. Pour des résultats contrastés. Il fallait en quelque sorte attendre qu’une institution reconnue (le MIT Review) s’y penche, pour que l’information monte au cerveau du plus grand nombre. 95 % des pilotes d’IA échouent à délivrer un retour sur investissement, estime-t-elle. Ce n’est pas vraiment nouveau, en réalité. Avant l’IA générative, 80 % des projets IA ne passaient pas le stade de la production, selon Gartner.
Il y a toutefois du mieux. Certaines entreprises communiquent sur les premiers retours des entreprises ayant déployé massivement des assistants IA. En France, l’on peut citer BPCE, TotalEnergies, ou encore Veolia. Deux ans pour déployer en production une solution à peine sortie des laboratoires de recherche fondamentale il y a trois ans, ce n’est pas si mal. Or, un paradoxe de l’IA s’imposerait, selon QuantumBlack, une filiale de McKinsey.
Les assistants IA synonymes de gains de productivité « diffus »
« Les déploiements à l’échelle sont souvent des cas d’usage horizontaux », observe Stéphane Bout, directeur général France de QuantumBlack, lors d’une table ronde organisée par Ekimetrics. « Des outils d’IA que l’on pourrait appeler outils de bureautique sont mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs pour faire de la traduction, de la synthèse de documents, du classement de mails, etc. ».
Les entreprises prennent souvent deux voies distinctes. Certains déploient des assistants « maison » basés sur les plateformes des fournisseurs cloud ou des outils internalisés. D’autres font le choix de déployer des licences de Microsoft Copilot ou de Gemini. C’est le cas de TotalEnergies qui a déployé 30 000 licences de Copilot.
« Ces outils amènent une valeur ajoutée indéniable aux métiers au quotidien, mais ils créent une productivité diffuse », note Stéphane Bout. « Ils n’apportent pas d’efficience comptable ou de revenus additionnels ».
La nécessaire transformation des processus clés
« Inversement, les cas d’usage verticaux pour optimiser des processus métiers, que ce soit le marketing, les ventes, la supply chain, les achats, et même l’IT n’ont pas été portés à l’échelle », ajoute-t-il.
Moins d’un projet IA spécifique sur dix aurait passé le cap du pilote. Et ceux qui sont en production concernent « l’optimisation d’une tâche individuelle dans un processus », ce qui aurait un « impact limité ».
Ce sont pourtant ces cas d’usage verticaux qui représentent davantage de valeur.
Les freins qui expliquent ces phénomènes ne sont pas nouveaux. Il y a des barrières technologiques que l’IA agentique est censée lever en partie. Les entreprises auraient laissé proliférer « les expérimentations de micro-cas d’usage très dispersés ». « Dans moins de 30 % des entreprises, l’agenda IA est supervisé par le CEO », affirme Stéphane Bout. De même, les équipes IA travailleraient en silo, en ayant peu de contact avec les métiers et très peu avec l’IT et les équipes data.
Sans oublier l’accès aux données de qualité et l’appréhension des métiers, « qui ont parfois peur pour leur emploi ».
Selon Stéphane Bout, il faudrait donc se « concentrer sur deux à trois cas d’usage à haute valeur ajoutée et y consacrer des moyens importants, massifs. Ensuite, il faut bâtir une trajectoire progressive pour y aller, dans une logique de transformation », conseille-t-il.
L’ajout des assistants et des agents IA dans les processus existants « permettra probablement de bénéficier de 20-30 % du plein potentiel », juge le directeur général France de QuantumBlack. Pour profiter pleinement de l’IA agentique, il convient de mettre sur pied une équipe pluridisciplinaire rassemblant les équipes IA, data, les métiers, tout en bénéficiant d’un sponsor de la direction. Ceux-là doivent revoir en profondeur les processus ciblés.
Miser sur l’IA, de manière générale
Pour autant, selon Ekimetrics et L’Oréal, l’IA générative n’est pas l’unique vecteur de transformation. Le groupe de cosmétique a déployé avec le spécialiste de la data science, une solution de modélisation du mix marketing. Cette technologie doit l’aider à gérer ce que L’Oréal appelle ses « moyens moteurs ». Il s’agit pour le groupe de simuler et de décider des sommes à investir dans les canaux de diffusion (publicité TV, bannières sur des sites Web, sponsoring YouTube, achat de mot-clé, etc.) susceptibles d’attirer les clients et donc de générer une part importante de ses revenus. Cela représente plusieurs milliards d’euros d’investissement.
« Nous avons codéveloppé avec Ekimetrics des modèles de machine learning, d’IA traditionnelle et petit à petit nous avons déployé la solution aux États-Unis, en Chine et dans l’ensemble de nos marchés », résume Stéphane Lannuzel, directeur du programme Beauty Tech chez L’Oréal. « Elle couvre la majorité de nos investissements commerciaux ».
Le sujet n’est donc pas réellement la technologie d’IA choisie, mais la manière de se l’approprier pour en tirer des gains substantiels. Ce serait d’ailleurs important de s’appuyer sur plusieurs technologies, ne serait-ce que d’un point de vue financier. « En temps normal avec l’IT, pour 10 euros investis, il y a un à deux euros de coût de fonctionnement. Avec l’IA générative, on peut avoir 20 euros de coûts de fonctionnement pour le même investissement au départ », illustre Stéphane Bout.
Un paradoxe utile
Ce qui ne veut pas dire qu’il faut débrancher les assistants IA, estime Stéphane Lannuzel.
« Ma grande conviction après quelques années, c’est que oui, nous allons laisser les collaborateurs s’approprier ces nouvelles technologies », affirme-t-il. « Nous avons créé notre Secure GPT depuis lequel les métiers peuvent créer des assistants et des agents IA. Pour les équipes marketing, nous avons mis à disposition une plateforme à partir de laquelle ils peuvent créer des images avec les derniers modèles [de diffusion] », liste-t-il.
Ces espaces de gains de productivité diffus et d’expérimentation seraient malgré tout utiles. « Cela permet de démythifier la technologie. De se préparer. Quand vous créez la première fois une image avec une IA, c’est un peu décevant », illustre Stéphane Lannuzel. « Cela montre qu’il faut se l’approprier ». De plus, la présence généralisée de ChatGPT (800 millions d’utilisateurs hebdomadaires) impose aux entreprises de proposer des expériences similaires.
Dans un même temps, un aspect nécessaire, mais difficile, serait de couper court aux expérimentations quand elles ne fournissent pas la valeur attendue. « C’est souvent une des décisions les plus difficiles à prendre. Et nous la prenons souvent trop tard. C’est plus complexe dans certaines géographies que dans d’autres pour des raisons culturelles », conçoit le directeur du programme Beauty Tech chez L’Oréal.
Ce qui implique de « mesurer la valeur et l’adoption ». Là encore, tout un projet.
Photo (en haut d’article) de Gaétan Raoul, lors de la table ronde organisée par Ekimetrics. De gauche à droite : Quentin Michard, cofondateur et DG Ekimetrics, Stéphane Lannuzel, directeur du programme Beauty Tech L’Oréal et Stéphane Bout, directeur France QuantumBlack (McKinsey).