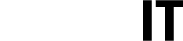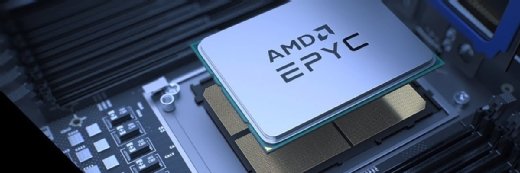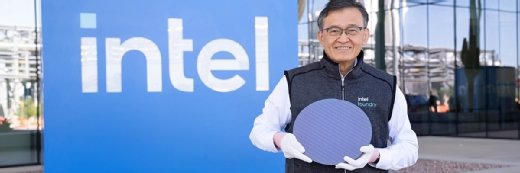
Contre toute attente, Intel affiche de bons résultats
Les bénéfices enregistrés ce trimestre, après des mois de pertes, s’expliquent essentiellement par les apports d’argent commandés par la Maison-Blanche. Un répit en attendant qu’Intel se repositionne sur les puces qui se vendent le mieux.
Intel vient de publier un résultat trimestriel de 13,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 3 % de son chiffre d’affaires en un an. Le fondeur réalise même un bénéfice de 4,1 mds $, contre une perte de 16,6 mds $ à la même époque l’année dernière. Ce sont de bons chiffres, d’autant plus que les analystes n’imaginaient pas qu’une telle progression soit faisable si rapidement au moment où le financier Lip-Bu Tan a repris la direction de l’entreprise en mars dernier.
Cela dit, les bénéfices ne sont pas dus qu’aux ventes. Ils s’expliquent en grande partie par des investissements extérieurs importants : le gouvernement des USA a apporté 5,7 mds $ (3,2 mds $ supplémentaires seront encore versés plus tard), Nvidia 5 mds $ et SoftBank 2 mds $. Ces investissements sont stratégiques pour l’Administration Trump, qui souhaite sortir les USA de leur dépendance aux puces fabriquées en Asie.
Par ailleurs, Intel a aussi touché 5,2 mds $ de la vente de ses filiales Altera (fabrication de FPGA) et MobileEye (logiciels embarqués).
Concernant les activités, la partie Client Computing, soit essentiellement la vente de puces pour PC, a réalisé un chiffre d’affaires de 8,5 mds $, ce qui équivaut à une augmentation de 5 % en un an. La partie datacenter – principalement les processeurs Xeon pour serveurs –, en revanche, continue de décliner avec un CA de 4,1 mds $, soit 1 % moins bien qu’il y a un an.
Il n’y a plus d’activité dédiée aux ventes de puces annexes (contrôleurs réseau…), celles-ci ayant été ventilées entre les catégories PC et serveurs. Le milliard restant, enfin, correspond à la vente de puces FPGA et de licences MobileEye avant la séparation de ces activités.
La partie Foundry, c’est-à-dire les usines, a refacturé en interne 4,2 mds $ pour fabriquer les processeurs de la marque. C’est un résultat 2 % inférieur à celui de l’année dernière. En substance, Intel a fabriqué un peu moins de puces et, surtout, n’est pas encore parvenu à commercialiser significativement la location de ses chaînes de production à des tiers.
Un avenir moins incertain pour les usines
Après ce trimestre aux rentrées d’argent exceptionnelles, Intel ne pourra plus compter que sur la réussite de ses stratégies commerciale et industrielle pour maintenir sa santé financière. Le fondeur prédit déjà que son prochain CA trimestriel sera équivalent, voire un peu moins bon, et que ses bénéfices redeviendront globalement nuls.
Lors de l’annonce de ces résultats, le PDG Lip-Bu Tan s’est montré pour la première fois optimiste quant aux perspectives de commercialisation des chaînes de production à des tiers. Cette relance d’Intel via des usines de semiconducteurs ultramodernes – susceptibles de concurrencer celles du Taiwanais TSMC dans le domaine de la sous-traitance pour des marques comme Nvidia, AMD ou Apple – avait été imaginée par le PDG précédent Pat Gelsinger. Elle lui avait aussi coûté sa place, tant les investissements étaient lourds pour une rentabilité à la fois incertaine et trop lointaine.
Initialement, la réputation de cost-killer de Lip-Bu Tan laissait craindre l’abandon pur et simple de ce projet, le nouveau PDG envisageant même de faire comme ses concurrents : s’en remettre entièrement à TSMC. Mais un rappel à l’ordre musclé de l’Administration Trump, qui a menacé de le destituer à cause d’une supposée intelligence avec la Chine, l’a manifestement fait changer d’avis.
De fait, la nouvelle usine Fab52, entrée en production cet été en Arizona, est sur le papier aussi performante que la dernière Fab22 de TSMC qui sait graver les puces avec une précision de 2 nm. Et des pourparlers seraient en cours avec AMD, voire Apple, pour fabriquer certaines séries de leurs prochains processeurs chez Intel. L’enjeu pour AMD et Apple serait de ne pas payer de lourdes taxes sur les circuits qu’ils font fabriquer en dehors des USA. Pour l’heure, TSMC ne peut leur proposer de fabriquer sur le sol américain que des circuits d’ancienne génération.
Rivaliser sur les modèles qui se vendent le plus
Concernant les puces, Intel renouvellera son catalogue en 2026 avec les processeurs Panther Lake pour PC – des Core Ultra de troisième génération capables d’exécuter des LLM sans passer par Internet –, les processeurs Xeon 6+ Clearwater Forest – qui intègrent jusqu’à 288 cœurs économes en énergie pour densifier les serveurs applicatifs – et le GPU Crescent Island pour accélérer l’inférence des IA en datacenter. Tous seront fabriqués dans l’usine Fab52. Ils devraient donc rivaliser en économie d’énergie avec les puces d’AMD et Nvidia fabriquées chez TSMC.
La stratégie semble de proposer des produits meilleur marché sur les segments qui se vendent le plus. Ainsi, le GPU Crescent Island devrait prendre place dans les mêmes types de clusters de serveurs que les DGX de Nvidia, mais ceux-ci coûteront bien moins cher et consommeront bien moins d’énergie. Car Crescent Island est une puce bien plus légère que les Blackwell de Nvidia, qui est de plus dépourvue de mémoire HBM et dont la puissance se limite à l’inférence de LLM. C’est-à-dire à l’utilisation d’IA préentraînées et non à leur entraînement.
Le design de la puce vaudra plus que l’architecture de ses cœurs, lesquels seront peu ou prou les mêmes que les Arc Xe3 qui arrivent dans les processeurs Panther Lake pour PC. L’arrivée récente de Nvidia au capital d’Intel, avec la volonté d’y imposer ses propres technologies, suggère qu’Intel pourrait à terme abandonner ses efforts de R&D en GPU et se contenter d’intégrer l’architecture de son concurrent.
Le Panther Lake, avec ses quatre cœurs performants, ses quatre cœurs basse consommation, et (en option) ses huit cœurs ultra basse consommation, est pour l’heure positionné sur le tout venant des PC portables compatibles IA. Il intègre 12 cœurs GPU et un circuit NPU renouvelé qui lui confèrent une puissance impressionnante de 180 TOPS (milliers de milliards d’opérations à la seconde), contre seulement 13 TOPS sur la seconde génération de Core Ultra, 38 TOPS sur l’actuelle génération de processeurs M4 d’Apple et 125 TOPS sur le processeur Ryzen AI Max+ d’AMD.
La grande nouveauté de ce Panther Lake est que, comme chez Apple et AMD, la mémoire est enfin unifiée : les cœurs x86, NPU et GPU accèdent aux mêmes adresses et il n’est plus nécessaire d’avoir le double ou le triple de mémoire chez Intel pour exécuter le même LLM que sur un PC AMD ou un Mac.
Le Xeon 6+ Clearwater Forest n’est pas une nouvelle génération de Xeon, mais plutôt une dernière évolution de l’actuel Xeon 6 qui, à défaut d’architecture innovante, bénéficie d’un savoir-faire hors pair dans l’assemblage. En substance, un gros socle d’interconnexion gravé en 10 nm (Intel 7) porte trois autres socles d’interconnexion gravés en 5 nm (Intel 3N), lesquels portent chacun 4 circuits de 24 cœurs gravés en 2 nm (Intel 18N).
Cette construction devrait permettre de proposer un Xeon en 288 cœurs moins cher que l’Epyc 9825 d’AMD, sans que cela coûte plus cher en énergie et en dissipation thermique.
Dans ce Xeon 6+, les cœurs ne sont capables d’exécuter qu’un flux d’instruction à la fois, d’où sa comparaison avec l’Epyc 9825 qui possède 144 cœurs (trois socles de 48 cœurs) capables d’exécuter chacun deux flux d’instruction simultanés. L’avantage de parvenir à mettre autant de cœurs dans la même puce est que celle-ci cumule plus de mémoire cache, soit 576 Mo sur le Xeon 6+, contre 384 Mo sur l’Epyc 9825.
En théorie, le Xeon 6+ serait donc bien plus performant que son concurrent pour exécuter des applications web en containers. En revanche, s’agissant de cœurs économiques, sans circuits d’accélération, le Xeon 6+ ne sera sans doute pas adapté aux calculs intensifs, contrairement aux Epyc.
Réduire les coûts
Rappelons qu’Intel avait déjà éliminé la possibilité d’exécuter deux flux d’instructions à la fois sur ses processeurs pour PC, y compris dans leurs cœurs performants. L’abandon de cette fonctionnalité a permis à ses processeurs de consommer aussi peu d’énergie (donc de préserver autant l’autonomie de la batterie) que les PC à base de processeurs AMD Ryzen gravés plus finement et toujours capables d’exécuter deux flux simultanés par cœur.
La multiplication des flux exécutables simultanément, que ce soit par ajout de cœurs physiques ou par une utilisation sophistiquée des pipelines au sein des cœurs (Hyperthreading), n’est véritablement utile que sur serveurs, pour y exécuter plusieurs VM ou plusieurs containers en même temps.
Toutes ces évolutions semblent indiquer qu’Intel lève le pied sur la course à la puissance pour se concentrer à présent sur la mise au point de puces bon marché. C’est grâce à une telle stratégie que tous les acteurs des semiconducteurs se sont enrichis dans le secteur des smartphones.
Dans un souci de réduction des coûts, le PDG d’Intel aura licencié cette année 20 500 personnes, dont la moitié de ses chefs d’équipe, et réduit ses investissements en R&D de 800 millions de dollars. Selon ses propos lors de l’annonce de ces résultats, les priorités du fondeur sont désormais la gravure, l’assemblage (le packaging) et la vente de ses puces sur les secteurs les plus porteurs.